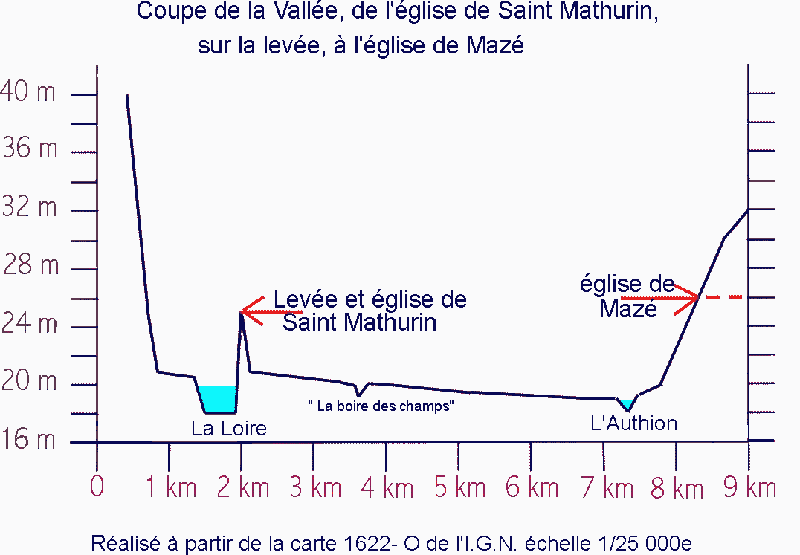
| pageweb1 | Table des matières | page suivante |
Partie 1
Chapitre I Un village entre Loire et Authion.
1) Un village né à l’abri de la Levée.
Le
cadre géographique.
Le nom de Vallée d’Anjou désigne la large
vallée de la Loire entre Ingrandes-de-Touraine aux portes de l’Anjou
à l’Est, et les Ponts-de-Cé à l’Ouest. Cette
vallée s’est creusée grâce « à
la présence d’un lit de marnes peu résistantes où
l’érosion a développé facilement ses progrès
après avoir tranché la masse des assises de craie. »
1
Au sud, le lit mineur de la Loire suit les coteaux de la rive gauche à partir de sa jonction avec la Vienne près de Candes. Au nord, la vallée est bordée de Restigné à Allonnes, par une terrasse d’une quinzaine de mètres ; puis, d’Allonnes à l’embouchure du Lathan près de Longué, par une basse terrasse de 5 à 6 mètres descendant par une faible pente jusqu’à l’Authion. La jonction du Lathan et de l’Authion éloigne le coteau de 15 à 20 km vers le nord en laissant des reliefs isolés (Brion). Une banquette discontinue taillée dans l’argile borde l’Authion sur sa rive droite entre Mazé et Brain.2(voir document 12, carte 1).
Cette vallée est légèrement bombée. L’Authion et les rivières du Changeon et du Lane qui lui donnent naissance, suivent un cours parallèle à la Loire, dans une dépression latérale située en contrebas de la vallée comme du lit mineur de la Loire. Jusqu’au XIXème siècle l’Authion se jetait dans la Loire juste en amont des Ponts-de-Cé.
Graphique 1
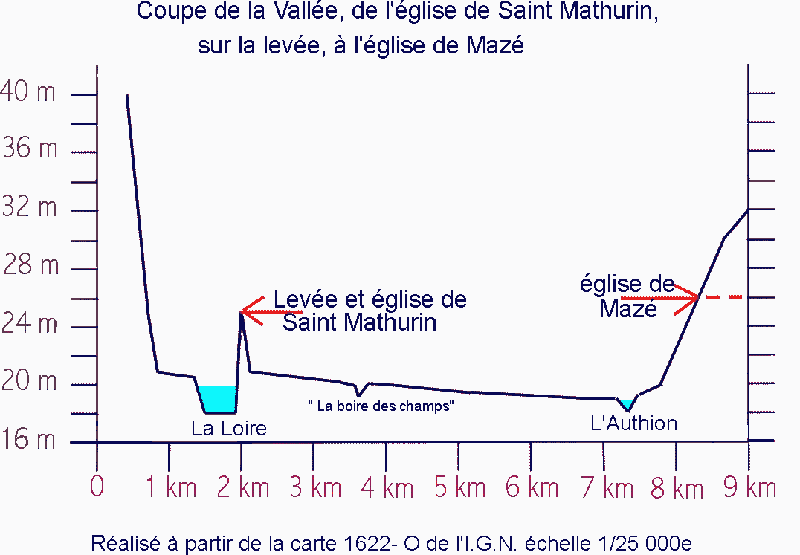
Dans la partie supérieure de la vallée (Chouzé) le dépôt alluvionnaire est relativement élevé par rapport au niveau du lit mineur de la Loire et du lit de l’Authion. Des buttes insubmersibles se succèdent d’est en ouest jusqu'à Saint-Martin-de-la-Place et aux Rosiers3.
Au-delà des Rosiers par contre, les terres basses et humides sont plus importantes.4 Or Saint-Mathurin est situé au cœur de cette vallée humide, entre la Loire et l’Authion. L’altitude de la levée de la Loire est de 25 mètres au bourg de Saint-Mathurin. Celle de la plaine alluviale est de 21 ou 22 mètres environ au pied de la levée et descend jusqu’à 18 ou 19 mètres au bord de l’Authion à Mazé. La dénivellation est de trois mètres sur cinq kilomètres.
Les inondations de l’Authion s’étendaient facilement dans cette partie aval de la Vallée d’Anjou, appelée aussi Vallée de l’Authion. C’était, jusqu’aux Ponts-de-Cé, le domaine des grandes prairies naturelles de l’Authion qui au XVIIIème siècle occupaient la moitié du lit majeur, de Sorges près d’Angers à Saint-Martin-de-la-Place près de Saumur. Nous verrons plus loin ces prairies, plus particulièrement celles qui constituaient des communaux, ou qui étaient soumises à un droit d’usage des habitants de la vallée après la fauche des foins par le propriétaire.
Des
débuts de l’occupation humaine aux levées de la Loire.
C’est dans la partie saumuroise, plus haute par rapport
au fleuve et plus sèche, que se trouvent, sur les points les plus élevés
appelés « montilles », les rares sites néolithiques
de la Vallée d’Anjou (Saint-Lambert-des-Levées) et les principaux
gisements de l’époque du Bronze et gallo-romaine (Saint-Martin-de-la-Place,
Chouzé, Villebernier)5.
Aux XIème et XIIème siècles des communautés
étaient établies à l’est de la vallée sur ces
mêmes montilles. Elles s’étaient fixées là pour
exploiter les terres cultivables de la vallée séparées
des paroisses des coteaux (Allonnes, Bourgueil…) par la dépression
de l’Authion. Une paroisse existait dès la fin du Xème
siècle à Saint-Martin-de-la-Place6.
Les montilles sont progressivement réduits aux abords du lit mineur à mesure que l’on suit le fleuve vers l’aval,7 ce qui explique l’occupation humaine limitée à partir des Rosiers, malgré l’existence de quelques implantations anciennes sur des monticules protégeant non de toutes, mais du moins de la plupart des crues : en 1849 on découvrit à Saint-Mathurin douze tombes du IVème ou Vème siècle8 dans un champs du canton du Chardonnet, lequel n’était que sous 40 centimètres d’eau lors de l’inondation de 18569. Mais aucun document n’indique une occupation entre cette période et le début du XIIIème siècle. La Vallée d’Anjou tardivement défrichée entre Longué et les Ponts-de-Cé paraît couverte d’une grande forêt au début du XIIème siècle10. La population se cantonnait principalement en bordure de la vallée, à Corné, Andard, Beaufort, Mazé, ou Longué.
On peut tout de même noter l’existence, au XVIIIème siècle, et encore de nos jours par endroits, d’un « chemin angevin », ou « grand chemin angevin », parallèle à la levée, à environ un kilomètre. Les traces de ce chemin s’étalent sur près de 10 kilomètres, depuis La Daguenière, jusqu’à Bellenoue à Saint-Mathurin où mène le dernier tronçon connu11. Il est possible que ce chemin soit un ancien chemin, antérieur à la levée et supplanté par elle. A Bellenoue, il ne pouvait mener qu’au « Patîs Potier » en obliquant vers le nord. De là, il était possible de rejoindre la « Via andegavensis » entre Mazé et Beaufort par le gué d’Anjan et le chemin de la Macrère. D’après la carte des inondations en 1910, le chemin du Pâtis Potier au coteau par le Gué d’Anjan était le plus court à travers la zone inondée. On peut donc raisonnablement penser que cette route était, depuis longtemps, une voie privilégiée pour traverser la vallée.
Les premières turcies12
Les turcies étaient des digues protégeant des inondations les cultures de la vallée. Les premières turcies médiévales virent le jour dans la partie saumuroise de la vallée entre les villages établis sur les hauts « chantiers » du fleuve, à 4 mètres au-dessus de l’étiage. Les « chantiers » correspondent à la partie élevée de la rive. Un chemin de rive reliait ces tertres élevés. Or il risquait d’être emporté lors des crues par les violents courants de débordement qui en quittant le lit mineur dans les parties déprimées des chantiers, creusaient ce chemin et répandaient du sable sur les terres cultivées. Des digues furent construites pour égaliser la hauteur des berges et ainsi éviter que les eaux débordant du lit mineur ne se concentrent sur les passages les plus bas.
Les abbayes Saint-Aubin d’Angers et Saint-Florent de Saumur, principaux propriétaires à l’est de la vallée, se plaignirent auprès d’Henri II Plantagenêt de la négligence des habitants dans l’entretien des digues. Habitant sur des tertres insubmersibles ils n’étaient pas menacés dans leurs vies et leurs biens par les inondations, alors que les propriétaires jugeaient les turcies indispensables à la mise en valeur des terres nouvellement défrichées.
Vers 1160-1170, Henri II décida d’encourager la fixation d’une population de colons près de la turcie en leur donnant des terres et en les exemptant de certains devoirs militaires, à charge d’entretenir la turcie. Des seigneurs suivirent son exemple et favorisèrent ainsi les implantations.13
La prolongation de la « levée ».
Le mot « levée », employé pour désigner la digue longeant la Loire, commença à se substituer à celui de « turcie » au XIIIème siècle et s’imposa définitivement au XVème siècle14. Le mot « turcie » continua à être employé pour les petites digues.
Si en amont de Saint-Clément-des-Levées les villages précédèrent les turcies, en aval des Rosiers, dans la section de vallée où se trouve Saint-Mathurin, la construction de la levée précéda sans doute l’apparition des villages. Cette partie de la levée a été créée pour mettre en culture la vallée.
Les comtes d’Anjou et les rois de France possédaient une part de la forêt qui couvrait la vallée. Ils favorisèrent l’expansion de la levée pour accroître leurs revenus : sans levées, les basses terres de la vallée étaient exposées à des inondations longues et fréquentes, qui rendaient les terres défrichées plus propres au pacage occasionnel des bestiaux qu’aux labours.
Au XIIIème siècle, grâce à la prolongation de la levée, la population de la rive crût fortement. Peu à peu elle s’étendit hors des tertres insubmersibles, sur les levées puis dans la vallée même15. Vers 1260-1268 il fallut bâtir une église aux Rosiers pour la population établie sur la digue ou près d’elle, (« supra turseiam et circa eam »)16. En 1365, nous savons que la levée atteignait le port de Sorges près d’Angers.17 Progressivement la levée fut préférée par les voyageurs à l’ancien « chemin angevin » (« Via andegavensis ») qui longeait la vallée au Nord sur la terrasse alluviale.
Les origines de Saint-Mathurin.
- En 1239, Dreu de Mello seigneur de Loches signait « apud Sanctum-Mathurinum » un don fait à l’abbaye de Beaulieu-les-Loches 18. Est-ce notre Saint-Mathurin ? Dans ce cas, la levée avait déjà atteint ce lieu à cette date à moins qu’un hameau ait existé avant la levée. Mais bien qu’un doute subsiste, c’est peu probable19, car des documents datés de 1340 à 1347 et concernant une dizaines de terres de Saint-Mathurin les attribuent à la paroisse de Saint-Rémy sur la rive gauche, sans une seule fois signaler le nom de Saint-Mathurin20.
- En 1335 Philippe VI reçu une supplique du chapitre de la cathédrale d’Angers portant que
« dans tout le canton nommé la Vallée d’Anjou, nouvellement rendu à la culture, il a été construit un grand nombre de maisons et de manoirs, tant pour l’habitation que pour la culture de la Vallée, mais à une très grande distance des églises paroissiales de cette contrée, dont l’accès est en outre souverainement difficile et périlleux pour ceux qui vont y entendre le service divin ou recevoir les sacrements » (traduit du latin par Marchegay).21
Les églises paroissiales en question étaient celles d’outre-Loire : Saint-Rémy, Blaison sans doute. En conséquence il ordonna de faire mesurer 4 arpents de ses terres de la vallée, à La Marsaulaye sur le territoire actuel de Saint-Mathurin, pour y faire construire une église, un cimetière et un presbytère. La population environnante était donc déjà conséquente à cette date.
- A la fin de l’année 1399 le seigneur du Verger, près de Seiches, fonda sur la levée « une pauvre chapelle ou aumosnerie » à Saint-Mathurin, desservie par un chapelain, mais en 1400 cette chapelle était encore « en la paroisse de St Remy la Varenne ou pays de vallée »22
Puis « par grant pitié qui fust tout solitaire, en temps d’iver, il n’avoit pour soy reconcilier et conforter aucun autre chapelain de son estat et pour l’accroissement du divin service et pour réconciliation de tout le peuple illecques environ habitant et aussi pour la reception et norrissement des pauvres », il donna par une nouvelle fondation un compagnon au chapelain.
Il devait « introduire en la foy les enfants qui illecques vendront et desquels il sera requis, c’est assavoir leur apprendre pour nyent le A. B. C. D., le Pater noster, Ave Maria, Credo, Benedicite, Te agimus, le Miseratur, le Confiteor, les Sanctus, les Agnus et le Dominus pronus, tant qu’ilz le sachent par cuer (…) et s’il est requis de plus avant les introduire, non mie qu’il y soit tenu, si non o salaire compectant »
Et pensant aux pauvres obligés d’emprunter du blé, le fondateur ordonna que l’on tienne en dépôt dans sa grange six setiers de seigle et six setiers de fèves pour les prêter « selon la charge d’enfans, aux plus souffretoux » sans intérêt et sous la promesse « en bonne foy » de le restituer à la récolte prochaine ou « jusqu'à ce que Dieu leur donne de quoy ou à eulx ou à leurs héritiers », avec défense de réclamer le remboursement de la dette.
La chapelle de cette aumônerie de Saint-Mathurin fut érigée en cure par décret épiscopal du 22 mars 1406. Elle devint le centre d’une paroisse.23 Nous ignorons si à cette date la paroisse de La Marsaulaye existait encore.
- En 1342 et 1343 Philippe VI fit don à Guillaume Roger (frère du pape Clément VI, grand soutien politique et financier du roi de France) de deux rentes de 1000 livres chacune, assises sur la prévôté de Beaufort. Ces rentes reposaient en partie sur un cens important payé pour des terres arables à La Daguenière et en des lieux qui plus tard firent partie de Saint-Mathurin : La Marsaulaye, Millerons, Fosselongue, la Boire du Râteau24. Grâce au procès-verbal d’assiette de la rente de 1344 nous savons que ces terres avaient été « nouvellement baillées à fromentage ».25
La
création du comté de Beaufort.
En 1344, Philippe VI abandonna au même Guillaume Roger
tous ses biens dans la châtellenie de Beaufort, sauf la haute forêt
et les droits de chasse, garde et justice en dépendant. Il l’autorisa
à prendre le titre de vicomte, puis de comte en 1347 par distraction
du duché d’Anjou.26
Le comte se plaignit toute sa vie des empiétements des officiers royaux,
qui entre autres concédaient à cens des parties de la forêt
pour être transformées en terres arables ou prairies. A cette époque
des défrichements furent réalisés au canton de Bellenoue
à Saint-Mathurin.27
Un document de 158028 nous donne les limites du comté à cette date. Si aucun document ne signale une modification des limites du comté de 1347 à la Révolution, nous savons que Saint-George-du-Bois ne faisait pas partie, au moins à la fin du XVIIe siècle, des communautés ayant un droit d’usage dans les prairies du comté. A cette exception près, les limites du comté paraissent stables durant son histoire.
Le comté englobait au nord de la Vallée tout ou partie des vieux villages chevauchant à la fois la vallée et le coteau, et dont les bourgs étaient à l’abri sur le bord de la terrasse alluviale : il comprenait une partie de Sorges, coupait Brain, Andard et Corné en suivant l’ancien « chemin angevin » au bord de la Vallée, englobait Beaufort, Saint-Pierre-du-Lac29 et Mazé en contournant sans doute Gée, comprenait encore une partie de Saint-Georges-du-Bois, une partie si ce n’est la totalité de Brion, et longeait Longué.
Au sud, il incluait le cours de la Loire, et une suite de villages entièrement compris entre le fleuve et l’Authion, et dont les bourgs sont encore accrochés à la levée : Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Les Rosiers, Saint-Mathurin, La Bohalle, La Daguenière.
Les limites étaient approximativement celles de la vallée récemment défrichée. Les parties de Corné, Brain et Andard qui échappaient à la vallée étaient exclues du comté. Le comté, et sans doute la châtellenie qui l’a précédé, c’était d’abord une vallée en pleine expansion, qu’il fallait surveiller et mettre en valeur (voir la carte du comté de Beaufort, document 14, carte 3, page 182).
La levée et sa sauvegarde du XVème au XVIIème siècle.
On ne connaît pas de rupture de levée avant le XVème siècle.30 Tant que les levées ne protégeaient que la Vallée d’Anjou, la Loire pouvait envahir les vallées en Touraine et dans l’Orléanais, qui agissaient comme d’immenses réservoirs, étalant les crues dans le temps et amoindrissant leur amplitude.
La confiance dans la levée s’accrut. En 1389 le fils de Guillaume Roger avait un manoir à La Ménitré, en pleine vallée inondable et tout près de la grange où se percevait les redevances en nature dues au Comté. Tout près de Saint-Mathurin aussi.31 Ce même manoir fut modifié par le roi René. Sa femme Jeanne de Laval y séjourna souvent, tout comme à Beaufort ou elle passa l’essentiel de son veuvage.32 La vallée n’était plus le domaine de quelques pauvres colons toujours à la merci des crues.
Mais les progrès de l’endiguement du fleuve en amont aux XVe et XVIe siècles annula ces effets. Les ruptures de levées commencèrent à se multiplier33 :
En 1456 la première était signalée. Les paroisses de la vallée envoyèrent cent hommes se relayer sur les deux brèches de Varennes-sous-Montsoreau.
Les suivantes se succédèrent en 1494, 1522, 1525, 1562 (près de Saumur) en 1570 et en 1586.
1615 prit pour la population le nom d’« année des grandes eaux »: Saumur était inondé.
Un ouvrage contemporain, « Le déluge de Saumur en 1615 », nous décrit la fièvre qui s’empara des habitants de la vallée lors de la monté des eaux : « l’on n’entendois que tocquesin battre iour et nuict de tous costez meslé avec le son enroüé des eaux et la clameur confuse du peuple qui trauailloit aux levées, à quoy faire il n’espargnoit aucune peine, et seroit incroyable d’entendre l’ouvrage qu’il fist en peu de temps, car en tels endroits les leuées furent haussées de deux à trois pieds, les maisons estoyent renuersées et les arbres abbatus pour les remparer, rien ny estoit espargné, et tenant la paesle d’une main il auoit les armes en l’autre, pour empescher le dessein qu’eussent peu auoir les habitans de l’autre rivage de Loire de coupper les leuées, pour se soulager faisant vuider les eaux dedans les vallées ». Malgré ces effort, la levée rompit sur 50 toises (100 mètres) un quart de lieue en aval de Saumur, sur 80 toises un peu plus bas et sur 250 toises (500 mètres) deux lieues plus loin34.
La levée était rompue, d’après le registre de Saint-Martin-de-la-Place (15 mars) en huit endroits de Sorges à Chouzé, et en cinq endroits d’après celui de Saint-Mathurin : Villebernier, Saint-Lambert-des-Levées, Saint-Martin-de-la-Place, Les Rosiers et Saint-Mathurin : « La levée rompit le 15 mars au Port-Pigeault en ceste paroisse de Saint Mathurin et vis-à-vis de la métairie de Champs d’oyseau (...) la vallée fut remplie d’eaues aussy haut que celle de la rivière et plus. »35
D’autres ruptures furent signalées dans la vallée d’Anjou en 1618 (aux Rosiers), en 1628, 1629, 1636, 1638, 1649, 1650, 1651, 1661, 1665, 1668, 166936...
Elle rompit en deux endroits à Saint-Mathurin en février 1638. Le 21 février 1669 trois brèches se formèrent dans ce village : au lieu-dit La Grande Levée, sous le presbytère et au milieu du bourg, emportant le logis de l’hôpital et une partie de l’hôtellerie du Lion d’or.37
La garde et les réparations de la levée étaient confiées aux paysans de la vallée, soumis à la « corvée des rivières », comme d’autres à la corvée des chemins. Ils étaient pour cette raison exemptés de la taille. Mais ils furent progressivement dépossédés de l’entretien des levées à partir de 1629 par l’Etat et l’administration centralisée des Turcies et Levées.... et par la même occasion soumis à la taille.38 L’Etat espérait ainsi assurer la régularité des travaux et leur solidité, et augmentait ses rentrées fiscales. Mais pendant la guerre de trente ans, Il ne put prendre en charge convenablement l’entretien de la levée, et à plusieurs reprises exempta de la taille les habitants, victimes d’inondations, à charge pour eux de rétablir la levée endommagée. Un arrêt du 4 juin 1668 (après une rupture) enjoint aux riverains de la Loire des Elections d’Angers et de Saumur de « réparer les digues avec du bois pris dans les îles, et d’y veiller pendant tout l’hiver moyennant une décharge de taille rejetée sur les autres contribuables desdites paroisses qui n’auraient rien fait ».
Un mémoire de 1661 nous fait le récit des inondations de 1629 à 1661, et nous renseigne aussi sur les péripéties de la progressive prise en charge de l’entretien des levées par l’état39:
Selon ce mémoire les habitants de la vallée d’Anjou furent soumis à la taille entre 1629-1634, mais les levées étant emportées en 1636 faute d’entretien, ils furent à cette date rétablis dans leurs privilèges. Ceux-ci furent révoqués en 1644, mais suite à la rupture de 1649 qui provoqua l’inondation de toute la vallée, ils obtinrent un sursis pour le paiement des tailles en 1649 et 1650, à charge pour eux de rétablir la levée. Mais en mars 1650 une nouvelle crue ruina tous leurs efforts. On construisit un batardeau (digue de pieux, terre et pierres) pour permettre aux habitants « d’ensemançer leurs terres qui leur avoient esté inutiles pendant deux années ». Il fut emporté en juillet. Les habitants firent un dernier effort pour réparer. Mais la crue de 1651 fit de nouvelles brèches. « de sorte que le désespoir et la faim ayant chassé la plus grande partie de ces misérables pour chercher leur subsistance en des lieux plus commodes », un arrêt du conseil (4/5/1651) les rétablit « en leurs antiens affranchissements » pour dix ans, et réduisit leurs impositions au « taillon » et aux droits des officiers des élections.
Mais ils se plaignirent d’être soumis à de nouvelles impositions portant sur des sommes supérieures à celles qu’ils payaient « pour les tailles et subsistences » avant leurs affranchissements. De plus ils avaient payé pour les réparations et les talus plus de 400 000 livres « non compris les corvées des habitans par leurs personnes, charrois & chevaux, dont le compte est impossible à faire, estant constant que dès l’année 1656. On justifia au conseil plus de sept cens mil journées d’homes, & charrois de beux, & chevaux. »
Malgré cela en janvier 1661 survint « une cruë la plus grande impetueuse qui ait esté veuë de memoire d’home vivant (…) nonobstant le soin de plus de dix mil habitans qui n’ont point espargné leurs arbres, leurs maisons, & leurs propre vies pour construire de petits batardeaux sur les levées, elle a emporté plus de six cent thoises [1,2 kilomètres] desdites levées en sept ou huit lieux différents. (...) à peine un homme à cheval peut presentement trouver passage (...) plusieurs personnes ont esté noyées, la plus grande parties des maisons proches desdites levées ont esté demolies, les arbres arrachez, tous les bestiaux noyez, & il se peut qu’après la retraite des eaues, si on peut y parvenir, grande partie des terres ne soit couverte de sable ».
La surveillance et l’entretien de la Levée au XVIIIème siècle.
A la fin du XVIIIème siècle l’administration royale surveillait de près l’état de la levée.
Le premier ingénieur des Ponts et Chaussées chapeautait le premier ingénieur des Turcies et Levées, qui remplissait un rôle d’inspecteur. L’Anjou dépendait de l’ingénieur du roi en chef pour la généralité de Tours (à la veille de la Révolution, M. de Marie), l’inspecteur Chevallier s’occupait de l’Anjou. Deux commis surveillaient le huitième canton (de Chouzé aux Rosiers) et le neuvième canton (des Rosiers à Sorges, y compris Saint-Mathurin). 40 En aval des Ponts-de-Cé l’entretien des digues était laissé aux riverains.
En 1668, Colbert imposa un règlement visant à assurer la solidité de la levée. Ses prescriptions furent renouvelées avec quelques modifications par un arrêt 1783.41 Les deux interdisaient de construire trop près de la levée, d’y creuser des excavations, de l’endommager de quelque façon que ce soit. Les commis de cantons dressaient des amendes aux contrevenants42, ce qui n’empêchait pas certains de continuer à faire pâturer leurs bestiaux sur l’herbe des talus, à enlever de la terre pour aplanir leur cour ou regarnir le potager, creuser hangars, caves, fours, puits ... sous la digue.43
La loi impliquait les villes et villages dans cette surveillance : l’arrêt de 1783 sur la police des rivières « enjoint aux maires, échevins, consuls, jurats, et syndics des villes et communes voisines de la Loire et des rivières y affluentes, de veiller à ce que les ouvrages (...) qu’elle prend sous sa sauvegarde royale ne soient ni dégradés, ni détruits, ni enlevés ».
En conséquence, le syndic de Saint-Mathurin fit en 1785 constater devant notaire les dégâts causés à la levée par du bois entreposé sur le chantier (la rive) par un marchand de Beaufort44.
Le même arrêt interdisait d’utiliser sur la levée plus de trois chevaux pour une voiture à deux roues, plus de six chevaux alignés par couples pour une voiture à quatre roues, et attribuait aux paroisses une part des amendes perçues45.
L’entretien était adjugé à de riches entrepreneurs, ce qui permettait d’assurer un approvisionnement rapide des matériaux nécessaires en cas de réparations urgentes.
D’autre part existait encore au XVIIIème siècle la « corvée des rivières », qui n’avait pas le caractère permanent de la corvée des routes. On réquisitionnait le personnel nécessaire en cas d’urgence. En 1784, pendant la débâcle des glaces, les voituriers par eau furent contraints de transporter le moellon pour couvrir les chantiers [les rives] menacés. La même année les habitants de La Daguenière furent tous appelés pour garantir la levée. L’arrêt de 1783 enjoignait aux maires, syndics ou consuls de prêter assistance aux ingénieurs, entrepreneurs, commis ou équipes de balisage des Turcies et Levées46. L’essentiel de l’entretien et des réparations étant à la charge de l’Etat, les riverains n’avaient plus droit comme au XVIIe siècle à des dégrèvements d’impôts en contrepartie de leurs travaux.
En 1752 l’ingénieur Montigny la décrit ainsi la structure de la levée47 :
« Le pied des glacis du coté de la Loire est défendu par des crèches qui règnent au long des levées, ces crèches sont faites de deux files de pieux très serrés distants de quatre pieds l’un de l’autre, un peu au dessous des têtes sont boulonnées des pièces de bois horizontales qu’on nomme limandes, prises et contenües par en haut par des traverses ou entretoises qui passent de l’une à l’autre file. Les pieux ont 10 à 12 pieds de longueur et ne laissent guère qu’un pied d’intervalle entre eux : on rempli de maçonnerie le dedans de ce pillotage et l’on tient la surface des crèches un peu au dessous des basses eaux. Aux endroits ou les glacis sont plus exposés à l’effort des eaux, ils sont revetus d’une maçonneries à pierre sèche qu’on nomme perrées. Les perrées sont quelquefois faites de gros cailloux, et quelques fois de quartiers de tuffeau rangés en gradins. »
Le « procès-verbal des bois communes et rivières de la grurie des Eaux et Forêts de Beaufort » de 1756 cite comme utilisation des bois de la forêt de Beaufort les « pieux pour l’entretient de la rivière de Loire »48
Nouvelles ruptures de levée et surélévation au XVIIIème siècle :
La prise en charge des levées par l’Etat n’empêcha pas les ruptures de continuer. On tenta d’empêcher la submersion des levées en les surélevant.
Louis XI avait fixé à 15 pieds au-dessus de l’étiage la hauteur des levées. Les rehaussements qui suivirent dans la première moitié du XVIe siècle (on releva la levée au-delà de 5 mètres), et ceux du XVIIe siècle (en Anjou entre 1682 et 1685) firent gagner au plus un pied. La hauteur de la levée était voisine, début XVIIIème, de 5.20 mètres, niveau approximatif des plus grandes crues connues.49
- Or en 1707 une grande crue (5.35 mètres à l’échelle des Ponts-de-Cé) submergea la levée et provoqua une rupture à la Chapelle-Blanche, à l’entrée de la vallée, « ce qui fit un tort considérable pour toute la vallée d’Anjou » (Registre de Saint-Martin-de-la-Place).50
Le gouvernement prit dans la précipitation la décision de rehausser la levée de 16 à 22 pieds au-dessus de l’étiage, soit près de 2 mètres.51
- En 1709 « La première et sanglante crüe commença le 9 juin 1709, qui ruina les vallées, l’eau passant par dessus la Levée, la Loire refoulant [par l’Authion] de telle sorte que dans un jour et demi on vit toute la Vallée, depuis la Daguenière jusqu’aux Rosiers, couverte de plus d’un pié plus haute qu’elle n’avoit été depuis la rupture de la Levée en 1707 » 52
- En novembre 1710 la levée rompit à nouveau à la Chapelle-Blanche :
« La vallée fut entièrement ruinée par l’eau, qui y descendit et coula longtemps. Les bleds que l’on ressema à différentes fois, furent inondés et perdus. Plusieurs maisons furent renversées, des murs et des granges jetés à bas, quantité de bétail noyez, mesme quelques personnes. Ces deux bresches furent reprises l’an suivant, et chaque maison ou ménage des paroisses circonvoisines furent obligez d’y envoyer une personne pour travailler à cela ; laquelle se nourissoit encore elle-même, ne recevoit aucun salaire de sa peine » (Registre Saint-Martin-de-la-Place).
- En février 1711, survint une terrible inondations :
Fin 1711 le desservant de Saint-Mathurin écrivait « Le quatrième février 1711 elle [la Loire] a monté si haut qu’elle remplissoit les deux brêches [à la Chapelle Blanche], qui ont fait une rivière de toute la vallée, et la rivière si pleine encore, que la levée menaçoit de ruine en plusieurs endroits ; ce qui a duré pendant les mois de février et mars, en sorte que tout ce monde fut obligé de gagner la levée ou les coteaux ». En février, des enfants de La Bohalle furent baptisés à Saint-Mathurin « à cause des grandes eaux »53.
Pour rehausser la levée en 1707, on avait simplement pris du sable à son pied, dans la vallée. Ces excavations fragilisaient l’assise de la levée en créant des mares appelées « piques » de levée, que l’on voit encore entre Saint-Mathurin et La Bohalle. Cette surélévation improvisée fragilisait aussi le haut de la levée car en débordant le courant creusait plus facilement dans le sable que dans les matériaux mêlés à des pieux serrés habituellement utilisés, ce qui augmentait la puissance des courants de débordement.
Avec la surélévation du fleuve au-dessus de la plaine, les ruptures de levée étaient plus dangereuses, les courants de débordement plus violents, le sable stérile répandu sur une plus grande surface. Mais on doit reconnaître que les ruptures furent moins nombreuses en Anjou après 1711. La levée résista à plusieurs fortes crues en 1740, 1744, 1789 et 1790.54
Le souvenir des catastrophes.
Si les habitants soumis à la « corvée des rivières » rechignaient souvent à s’y soumettre pour l’entretien, ils ne se faisaient pas prier pour défendre la levée en cas de menace pressante, par crainte de voir le fleuve emporter récoltes, bétail et maisons dans ses débordements. La défense de la levée devenait l’affaire de tous. Les populations récupéraient où elles pouvaient les matériaux nécessaires à la consolidation de la levée. En 1767 le juge de la grurie royale des Eaux et Forêts de Beaufort interdisait d’abattre les arbres des communes du comté « fors dans la necessité urgent des ruptures des levées de la Loire »55. Et dans un bail à ferme de 1788, il était demandé au preneur « de combler incessement un trou qui a été fait dans la cour de la dite maison de la Boucquetterie pour emporter sur la levée »56
A ces occasions les habitants de la vallée se racontaient ce qu’ils savaient des précédentes ruptures de levée et des terribles inondations qu’elles avaient provoquées.
Une lettre datée de 1783 du sieur Chevallier inspecteur des Turcies et Levées donne un aperçu de la panique qui s’empara des habitants du voisinage de Saint-Mathurin et des Rosiers lorsqu’une crue atteignit le niveau de la Levée57 :
« L’alarme est dans nos cantons, les trois rivières de la Loire, de la Vienne et du Thouet donnent à la fois et portent les eaux à plusieurs endroits jusqu’au niveau du pavé de la levée (...) les habitants effrayés au delà de ce que je peux vous exprimer, par le malheur évident que les mémoires s’exaltent par la tradition qui leur fait s’entre.... qu’on a vu la Loire, s’ouvrant des brèches, devancer dans la vallée des personnes qui cherchaient à se sauver à course de cheval, qu’on a vu cabrer des maisons et abîmer les habitants grimpés sur les toits, et présenter dans ces déluges de la vallée le spectacle des bestiaux à la nage, d’enfants flottant dans leurs berceaux et d’hommes se sauvant dans les arbres ; enfin la moitié de ces habitants sont sur la levée pour l’exhausser, pour raccommoder les brèches tandis que l’autre moitié fuit avec bestiaux vers la côte du nord, sans nourriture. Nombre de femmes en couche et de malades sont abandonnés aux événements ».
NOTES DE BAS DE PAGE (WEB)
1
Roger Dion. Le Val de Loire. Etude de géographie Régionale.
Page 156.
2
Roger Dion, op. cit. page 101.
3
Elles apparaissent dans la toponymie, sous les termes de « varennes »
(sols sablonneux et maigres), « montilles »,
« hauts », ou « peu » (variable
locale de « puy » désignant une élévation).
4
Roger Dion, Le Val de Loire. Etude de géographie régionale. ,
page 211: « A partir de la butte des Montilleaux, près
des Rosiers, qui représente leur dernier prolongement occidental [des
buttes insubmersibles], le grand lac formé dans la vallée,
par l’inondation de 1856, s’étalait ininterrompu jusqu’aux
Ponts de Cé, sur plus de 20 kilomètres de longueur ».
5
Jacques Gras. De la Vallée d’Anjou. au plateau du Baugeois.
page 101.
6
Célestin Port. Dictionnaire historique et biographique de Maine
et Loire. article « Saint-Martin-de-la-Place ».
7
Roger Dion, op. cit. pages 320 et suivantes.
8
Célestin Port, op. cit., article « Chardonnet ».
A côté du champs du Chardonnet passe selon Roger Dion un chemin
qui traversait l’Authion au Gué d’Anjan, sur un pont détruit
en 1843 et que Célestin Port datait d’époque romaine (article
« Gué d’Anjan »). A tort puisque ce pont
n’existait toujours pas en 1785, d’après les cartes des terrains
de l’Ancienne forêt de Beaufort. A.D.M.L. : 1Fi 482.
9
Roger Dion. op. cit. page 314.
10
Roger Dion, op. cit. page 277. Il cite le livre noir de Saint-Florent
de Saumur CXXVIII, 1120-1124. (Marchegay Archives d’Anjou
page 279).
11
Cartes I.G.N. 1622 O « Mazé » au 1/25000e.
Cadastre napoléonien 3P4/320 (Saint-Mathurin) et 3P4/123 (Daguenière).
Et A.D.M.L., 5E16/272, partage biens Urbain Leblanc 3/12/1782 « le
grand chemin angevin du pont au foullon au pasty de Bellenoue. »
12
Cette partie comme la suivante doit beaucoup à Roger Dion, op. cit.,
pages 324 à 343.
13
pour le texte de la charte d’Henri II, voir Champion (Maurice) . Les
inondations en France depuis le VIe siècle jusqu'à nos jours.
4 Tomes. page 206, et la nouvelle lecture par Charles Billiard dans « La
naissance de la Vallée d’Anjou à l’époque des
grands défrichements ». Cahier N°3 de l’Observatoire
de la Vallée d’Anjou.
14
Roger Dion, op. cit., pages 340 et 353.
15
Roger Dion, op. cit., page 341-342.
16
Célestin Port, op. cit., article « Rosiers »,
dans les éditions du XIXème siècle. Il se
réfère à un document des A.D.M.L., G386.
17
D’après Roger Dion, op. cit. page 341, Charte du cartulaire
de Bourgueil citée par Mabille dans « notice sur les divisions
territoriales et la topographie de l’ancienne province de Touraine. »,
1866, page50 No 2.
18
Pastoret (comte de). Ordonnances des rois de France de la 3e
race ,16e volume, page 72. Acte de Louis XI sept. 1463 : confirmation
d’une franchise. Trouvé grâce aux notes de Toussaint Grille,
B.M.A : ms 1766, « St Mathurin ».
19
Malgré tout, on peut noter que le Dictionnaire historique de Célestin
Port et le Dictionnaire géographique historique et biographique
d’Indre et Loire et de l’ancienne province de Touraine. ne signalent
pas de paroisse de ce nom, ou de chapelle suffisamment isolée d’une
paroisse pour donner son nom à un lieu-dit. De plus l’abbaye de
Beaulieu-les-Loches possédait tout près de Saint-Mathurin-sur-Loire
le grand domaine de la Roche-aux-Moines à Mazé, donné
en 1040 par Hildegarde veuve de Foulque Nerra. Cela pouvait justifier l’intérêt
porté aux problèmes de l’abbaye par Dreu de Mello de passage
à Saint-Mathurin sur la route de la levée. En 1785 cette terre
rapportait encore à l’abbaye 1000 livres de rente. (L. Archambault. « Histoire
de l’abbaye et de la ville de Beaulieu » , R.A.
août 1873 page 68.) Le chapitre de Loches possédait quant à
lui la seigneurie de Corné. (Célestin Port, article « Corné ».)
20
A.D.M.L., 1HS/B245. Rentes de l’Hôpital St Jean d’Angers à
Saint-Mathurin. Folios 355, 358, 360, 361 , 365. Reconnaissance de rente,
actes de vente, contrats de mariage…
21
Marchegay , R.A., 1873, T1, pages 292-293. D’après des lettres
de Jean, fils aîné du roi de France, de juin 1336. B.N., Mss.
Collection de dom Housseau.
22
A.D.M.L., G 2274. Fondation de messe du 1/2/1400 par le sieur Olivier Barbe
de Seiche.
23
Célestin Port, op. cit., article « Saint Mathurin ».
Dans les éditions du 19e siècle. Cite le Chartrier
du château du Verger.
24
C. Rivain. Beaufort en Vallée et son château de
1342 à 1380. 1888, pages 11 et 13. Sur le même sujet Arnaud
Guitton La reconstruction du château de Beaufort en Vallée
d’après un livre de comptes de 1348. Mémoire de maîtrise
1988.
25
A.N : K1144 No 36, d’après Roger Dion, Op. cit. page
342.
26
C. Rivain, op. cit., pages 14 et 15.
27
C. Rivain, op. cit. pages 61 et 62.
28
Lettres patentes de François d’Alençon. 1580. dans Joseph
Denais Le portefeuille d’un curieux. p. 56-64. (Article de la
Revue de l’Anjou)
29
succursale de Beaufort, maintenant réunie à cette commune à
la révolution. Voir François Lebrun les hommes et la mort
en Anjou, appendice V.
30En
1856, Célestin Port ne signale pas de rupture de levée dans
les textes des 13e et 14e siècles : « Les
inondations dans le département de Maine et Loire » dans
Questions angevines. C’est un article de la Revue de l’Anjou
1856. T1, p.360-374.
31
Roger Dion, op. cit. page 343 : Lettre du 4/6/1389 « en
nostre hôtel de la Ménitré ». Dion cite
Justel Histoire généalogique de la maison de Turenne.
1645, preuves page 97.
32
Arnaud Guitton. Le château de Beaufort en Vallée des
origines à nos jours. 1988. page 45.
33
Sauf indication contraire : Célestin Port, op. cit. Les sources
indiquées entre parenthèses en sont tirées.
34
Bourneau. Le déluge de Saumur en 1615… Nouvelle édition
de 1843, page 8.
35
Archives de Saint-Mathurin, B.M.S.
36
Célestin Port, op. cit. , et le « factum »
qui suit pour 1649, 1650, 1651 et 1661. Liste non exhaustive...
37
Célestin Port. Dictionnaire Historique, Biographique... article
« Saint Mathurin »
38
Roger Dion, op. cit. page 377.
39
« Factum contenant les misères, calamitez et ruïnes
arrivées dans les paroisses de la Vallée d’Anjou par les
ruptures des levées de la rivière de Loyre, en l’année
présente 1661 » A.D.M.L., 8-B-37
40
L. Marboeuf, op. cit. pages 10 à 14.
41
Roger Dion, op. cit. page 381-382.
42
A.D.M.L., C 25. Procès-verbal de Michel Auger commis des turcies et
levées, chargé de faire construire une jetée au pied
de la levée, contre le sieur Daguet qui a construit « dans
l’ancien port de l’eau », bourg de Saint-Mathurin,
des piliers pour soutenir sa maison, et un mur. 1787.
43
L. Marboeuf, op. cit. page 43.
44
A.D.M.L., 5E13/331. Procès-verbal du 20/6/1785.
45
L. Marboeuf, op. cit. page 17.
46
L. Marboeuf, op. cit. page 21
47
Mignot de Montigny. « Voyage dans l’Orléanais, le
Blesois, la Touraine, l’Anjou et la Bretagne ». 1752.
page 88 du « voyage », Edition critique par Marie Thérèse
Cottenceau.
48
Archives de Beaufort, DD6 (ex DD5)
49
Roger Dion, op. cit. page 386.
50
Sur les inondations : Célestin Port « Les inondations
dans le département de Maine et Loire » dans Questions
Angevines., et dans la R.A. (1856 , T1). Les sources indiquées
sont les siennes, sauf notes en bas de page.
51
Roger Dion, op. cit. page 386.
52
A.D.M.L. : 5G1 à 3. René Lehoreau Cérémonial
de l’église d’Angers, livre V p. 78. Pub. par François
Lebrun.
53
Archives de Saint-Mathurin, fin du registre des B. M.S. de 1711, et mois de
février. Les coteaux sont ceux du nord de la Vallée (Corné,
Mazé, Beaufort…) ou ceux de Saint-Rémy sur l’autre
rive de la Loire.
54
Célestin Port, op. cit.
55A.D.M.L.,
8-B-37.
56
A.D.M.L., 5E16/276. Bail à ferme du 10/7/1788, Marie Esmery
à Pierre Gendron.
57
A.D.M.L., C 22. Copie d’une lettre écrite à l’intendant
de Tours, 1783. Célestin Port affirme qu’à cette occasion
la levée creva aux Rosiers sur 150 pas (Op. cit.)