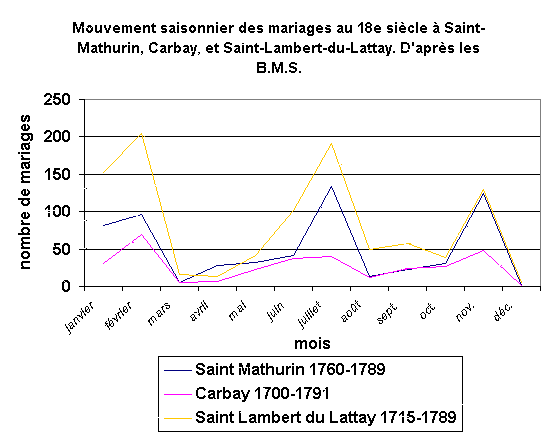
| pageweb9 | Table des matières | page suivante |
3) La démographie.
Mouvement
saisonnier des mariages.
Pour étudier le mouvement saisonnier des mariages dans leur ensemble,
j’ai utilisé les « tables décennales »,
sur la période 1760-1789, qui m’ont fourni 611 dates de mariages.
355 mariages sur 611, soit 58%, furent célébrés pendant les mois de février, juillet et novembre.
On se mariait en janvier et février avant le carême, en juillet avant les moissons, et en novembre entre les semailles et la période de l’Avent. Les périodes de pénitence de l’Avent (décembre) et du carême étaient bien respectées. « L’avent commence le dimanche le plus proche de la Saint André (30 novembre) et se termine à l’épiphanie (6 janvier) (…) Le carême correspond aux quarante six jours qui précèdent Pâques, mais la date de Pâques varie d’une année sur l’autre, selon le comput ecclésiastique1 ». En conséquence, les mariages en mars, avril et décembre représentaient 5.6% des mariages, et pour les trois-quarts en avril. Un seul mariage sur 611 eut lieu en décembre. Les mariages en août, septembre et octobre, périodes de gros travaux agricoles, étaient peu nombreux. Ils représentaient 11% des mariages. La répartition des mariages est proche de celle observée à Saint-Lambert-du-Lattay entre 1715 et 1789.2 Par contre la répartition des mariages était plus étalée à Carbay3, où 48% des mariages avaient lieu en février, juillet et novembre. La différence était essentiellement due au plus grand nombre de mariage entre août et septembre(19.4% contre 11%).
A Saint-Mathurin le nombre de mariage était particulièrement faible en juin (6.7%), comparé à celui observé à Carbay (11.4%) et Saint-Lambert-du-Lattay (12.8%).
Tableau 7 : le mouvement saisonnier des mariages au XVIIIème siècle à Saint-Mathurin, Carbay et Saint-Lambert-du-Lattay, d’après les B.M.S.
|
|
janv. |
fév. |
mars |
avril |
mai |
juin |
juillet |
août |
sept. |
oct. |
nov. |
déc. |
|
Saint-Mathurin 1760-1789 |
81 |
96 |
5 11e mois |
28 |
32 |
41 |
134 |
14 10e mois |
23 |
31 |
125 |
1 12e mois |
|
Carbay |
31 |
70 |
5 11e mois |
7 |
23 |
37 |
40 |
12 |
24 |
27 |
48 |
1 12e mois |
|
Saint-Lambert
-du-Lattay |
152 |
205 1er mois |
16 10e mois |
13 11e mois |
41 |
102 |
191 |
50 |
57 |
39 |
130 |
5 12e mois |
graphique 2
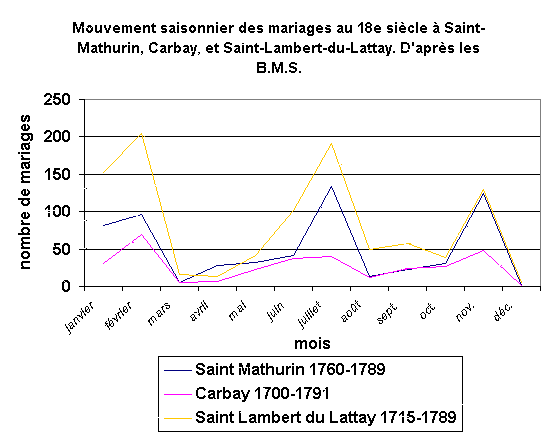
Mouvement saisonnier selon les
professions.
J’ai étudié les dates de mariage selon les professions
à travers les mariages de 1755 à 1771, en comparant les bêcheurs
(185), les laboureurs (46, y compris un métayer que j’ai ajouté
ici, car les locataires de métairies étaient habituellement des
laboureurs), et tous ceux dont la culture de la terre n’était pas
l’activité principale (56 : notables, commerçants, domestiques,
etc.). Sur le graphique, les courbes des mariages des laboureurs et des non-cultivateurs
sont basées sur des chiffres multipliés par 3 pour faciliter la
comparaison avec la courbe des bêcheurs. On retrouve dans
les 3 courbes obtenues le même respect du Carême et de l’Avent.
Par contre les laboureurs étaient peu nombreux à se marier en novembre (6.5%), un mois qui regroupait pourtant 22.7% des mariages de bêcheurs, et 12.5% des mariages parmi les non-cultivateurs. D’autre part les laboureurs se mariaient un peu plus souvent que les autres en février, mai et juin. Les époux des deux autres catégories étaient aussi peu nombreux à se marier en juin, sans que j’en connaisse la raison. La courbe des mariages des laboureurs est plus aplatie. La hausse des mariages à la fin de l’année commence dès octobre pour les non-cultivateurs, alors qu’elle est concentrée sur le mois de novembre, après la moisson, pour les bêcheurs.
Tableau 8. Mouvement saisonnier des mariages à Saint-Mathurin selon les professions. 1755-1771.
|
|
janv. |
fév. |
mars |
avril |
mai |
juin |
juillet |
août |
sept. |
oct. |
nov. |
déc. |
|
bêcheurs (185) |
31 |
19 |
3 |
6 |
7 |
7 |
47 |
5 |
3 |
7 |
42 |
|
|
laboureurs(45) |
7 |
11 |
|
2 |
4 |
4 |
10 |
|
3 |
1 |
3 |
|
|
métayer (1) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
domestiques |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
||||
|
batelier |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pêcheur |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
emp. des gabelle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
charrons |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
charpentiers |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
cordonniers |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tonnelier |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
menuisiers |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
sabotiers |
|
1 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
taillandier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
maréchal-ferrant |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tailleur de pierres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
tanneur |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tisserands |
3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
meuniers |
3 |
1 |
|
|
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
|
march. boulanger |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
maître perruquier |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
chirurgiens |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
« marchands » (souvent md. fermiers) |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
2 |
|
|
2 |
1 |
|
|
md. mercier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Total Artisans-commerçants-notables … (56) |
10 |
9 |
2 |
2 |
1 |
13 |
2 |
1 |
8 |
7 |
1 |
graphique 3
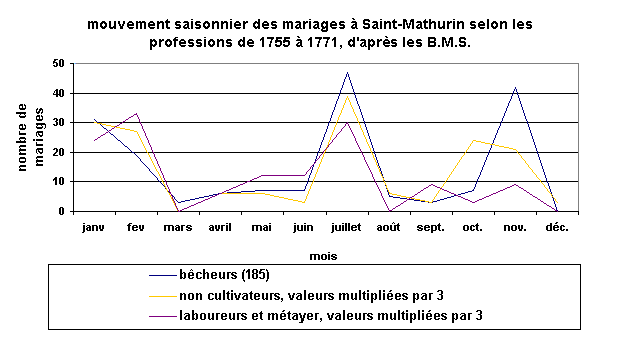
Les
remariages.
Sur les 322 mariages entre le 1er
janvier 1755 et le 31 décembre 1771, seuls 16.8% concernaient un veuf
ou une veuve. Ce chiffre est extrêmement bas. Dans d’autres paroisses
d’Anjou où les remariages ont été étudiés,
le pourcentage habituel est plus proche de 30% : il est de 45% à
Carbay, 25% à Chanteloup, un peu plus de 30% à Saint-Michel-du-Bois,
29.5% à Saint-Lambert-du-Lattay, et 21.9% à Saint-Clément-des-Levées4.
A Saint-Mathurin, les veufs représentaient 11.5% des époux, et les veuves 8% des épouses, contre 30.4% et 23.4% à Carbay, 23% et 13.5% à Saint-Lambert-du-Lattay, 17% et 9.2% à Saint-Clément-des-Levées, où les chiffres sont plus proches de ceux de Saint-Mathurin.
De nombreuses vérifications dans les tables décennales ont montré que les pourcentages trouvés à Saint-Mathurin n’étaient pas faussés par des veufs et veuves non signalés comme tels dans les registres de mariages.
La période choisie pourrait expliquer cette situation. La démographie des autres paroisses que nous venons de citer a été étudiée sur de longues périodes, couvrant les trois quarts au moins du XVIIIème siècle, sauf à Saint-Clément-des-Levées où l’étude portait sur la période 1750-1789. Par contre les mariages de Saint-Mathurin, ont été étudiés sur 17 années, de 1755 à 1771 compris, et ce en raison du grand nombre d’actes dans cette communauté très peuplée. Or François Lebrun signale : « on constate presque partout, jusqu’en 1750 des oscillations souvent brutales autour d’un niveau moyen, entre 1750 et 1760 un décrochement, presque un effondrement des chiffres de sépultures, enfin, à partir soit de 1770, soit de 1780, un relèvement plus ou moins brutal de ces chiffres, notamment dans les années 1779-1785 »5. Le remariage des veufs et veuves étant habituellement rapide, l’effondrement des décès durant cette période réduit d’autant le nombre de candidats au remariage. Les faibles chiffres observés à Saint-Clément-des-Levées peuvent s’expliquer par la période durant laquelle les mariages ont été étudiés, qui s’étend en grande partie sur cette période de faible mortalité.
Tableau 9 Situation matrimoniale des époux à Saint-Mathurin. 1755-1771.D’après les B.M.S.
|
maris |
ensemble |
|||
|
garçons |
veufs |
|||
|
femmes |
filles |
268 |
28 |
296 |
|
veuves |
17 |
9 |
26 |
|
|
ensemble |
285 |
37 |
total : 322 |
|
Grâce aux « tables décennales » des sépultures, on connaît la période de veuvage quand le conjoint précédent est décédé à Saint-Mathurin. Sur 21 veufs dont pour lesquels on dispose de cette information, le veuvage durait en moyenne 24 mois (23.57 mois, mais je n’ai relevé que le nombre de mois, pas de jours. Il doit donc manquer environ 15 jours par veuvage.). Trois veufs se remarièrent après trois mois de veuvage, et le dernier au bout de 74 mois.
Pour les 21 veuves dans le même cas, le veuvage dura en moyenne 41 mois. Elles se remarièrent entre 11 et 166 mois après le décès de leur époux. Ces chiffres correspondent à la tendance générale des veufs à se remarier plus vite que les veuves6. A Saint-Clément-des-Levées, les veufs se remariaient en moyenne 1 an et demi après leur veuvage, et les femmes 2 ans et demi après7. A Carbay, au bout de 18 mois 70.2% des hommes et 42.5% des femmes étaient remariés8.
Origines et professions des
veufs et veuves à leur remariage.
La paroisse de baptême
(ou d’origine déclarée quand ce n’est pas Saint-Mathurin)
est connue pour 34 veufs. Dans trois cas la paroisse est inconnue, mais n’est
manifestement pas Saint-Mathurin (pas d’actes de naissance, pas de parents
à Saint-Mathurin.). Les veufs se remariant nées à Saint-Mathurin
représentent 51%, contre 64 à 70% pour l’ensemble des mariés.
Ceux désignées de Saint-Mathurin sont 62% contre 74% pour l’ensemble
des époux. De même les veuves nées à Saint-Mathurin
sont 57%, contre au moins 78% pour l’ensemble des épouses. Leur
paroisse dite d’origine est Saint-Mathurin dans 76% des cas, contre 91%
pour l’ensemble des épouses. Les veufs et veuves hésitaient
donc moins à se déplacer pour se remarier.
Dans 30 cas sur 37, les professions des veufs sont connues, et elles concordent avec celles observés pour l ‘ensemble des époux. On trouve 30 bêcheurs(62%), 5 laboureurs (16%), un charpentier, un meunier, un marchand, un tisserand, un maître chirurgien et un métayer.
Les professions de 22 époux des 26 veuves sont connues. Les bêcheurs ne sont que 11 (50%), mais le faible nombre de cas connus interdit d’en tirer des conclusions.
L’âge
au mariage.
L’âge au mariage était indiqué
dans plus des trois quarts des actes de mariages entre 1755 et 1771. Pour les
autres conjoints, il a fallu retrouver la date de naissance par les « tables
décennales ».
Il s’est avéré que près du quart des âges au mariage déclarés étaient faux. La plupart des erreurs concernaient une à trois années, parfois jusqu’à dix années pour les personnes les plus âgées. A une époque où savoir sa date de naissance n’avait pas la même importance que maintenant, la connaissance des âges était approximative. Et le prêtre le jour du mariage ne faisait pas de recherche dans les actes de baptêmes, qui étaient les seuls documents à garder la trace de la date de baptême. Le baptême avait lieu ordinairement le jour de la naissance ou le lendemain. Je n’ai pas trouvé de baptême éloigné de plus d’une journée de la naissance.
Les vérifications dans les « tables décennales » et dans les actes de baptême ont été facilitées par l’indication presque systématique dans les actes de mariages, des parents des époux. Il restait à vérifier, y compris dans les actes de sépultures, que la date de naissance trouvée ne correspondait pas à un frère ou une sœur du conjoint, mort avant sa naissance, et dont il aurait repris le nom. Il était d’ailleurs fréquent qu’un âge au mariage erroné corresponde à l’âge qu’aurait eu ce frère ou cette sœur décédé.
C’est au cours de ces vérifications systématiques de tous les âges des époux pour les 322 actes de mariage, qu’il est apparu que de nombreux conjoints, désignés dans l’acte de mariage « de cette paroisse », n’avaient pas été baptisés à Saint-Mathurin (J’ai développé plus haut le problème de l’origine des conjoints).
Dans les cas où je n’ai pu retrouver l’acte de naissance, particulièrement pour les conjoints nés hors de Saint-Mathurin, j’ai repris l’âge déclaré au mariage.
- Dans 46 cas (14.29%), l’âge
au mariage de l’homme reste inconnu.
Dans les 276 autres cas, l’âge moyen des hommes au mariage était
de 29,8 ans (En fait un peu plus de 30 ans car je n’ai déterminé
l’âge qu’en années, sans tenir compte des mois. Il faut
donc en moyenne ajouter 6 mois).
Parmi les 30 veufs dont l’âge est connu, l’âge moyen au
remariage était de 39.34 ans. Parmi les 246 époux dont c’était
le premier mariage, l’âge moyen était de 28.7 ans (29 ans).
- Pour les femmes, l’âge
au mariage est inconnu dans 23 cas, soit 7.1%
L’âge moyen des femmes
au mariage était de 26,56 ans (en fait 27 ans, car l’âge
n’a été calculé qu’en années). Parmi ces
femmes, 24 veuves se mariaient en moyenne à 38.29 ans, et les 275 femmes
dont c’est le premier mariage, à 25.54 ans (26 ans).
Ces chiffres sont très proches de ceux trouvés dans d’autres villages de l’Anjou. A Saint-Lambert-du-Lattay, les hommes se mariaient à 27 ans et 6 mois au premier mariage, et à 29,6 ans pour l’ensemble des mariés, y compris les veufs. Les femmes se mariaient à 23 ans et 9 mois au premier mariage, et à 26,2 ans pour l’ensemble. A Carbay, les hommes se marient à 26.2 ans, et les femmes à 24.1 ans, et à Saint-Michel-du-Bois, à 27 et 24 ans. A Saint-Clément-des-Levées, les premiers mariages avaient lieu à 28 et 27.5 ans.
Les écarts d’âge entre époux étaient relativement modérés, et tout à fait comparables à ceux que l’on observe encore de nos jours. En 1993, l’âge moyen au mariage était de 28.7 ans pour les hommes et 26.7 ans pour les femmes9.
Graphique 4
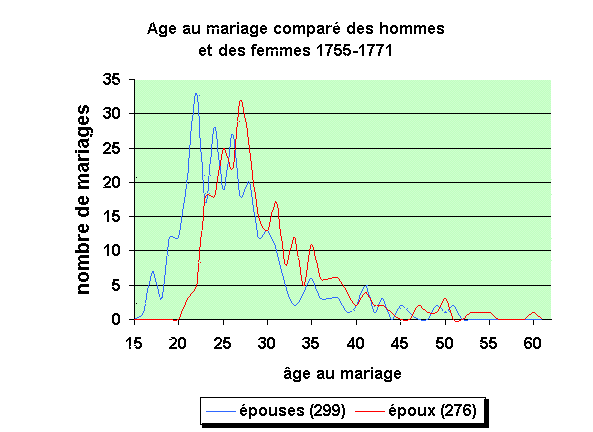
L’influence des professions sur l’âge au mariage était minime. Sur 170 bêcheurs dont la profession est connue, parmi lesquels 15 veufs, l’âge au mariage était de 29.8 ans. Sur 29 artisans (3 veufs), l’âge au mariage était de 28.24 ans. Sur 41 laboureurs (4 veufs), il était de 30.7 ans, et sur 8 marchands (1 veuf), de 30 ans. Le nombre de veufs se remariant reste proche de 10% dans ces différentes catégories.
Les
variations saisonnières de la fécondité.
L’étude
des enfants des 322 couples mariés entre 1755 et 1771 permet de se faire
une idée des variations saisonnières de la fécondité.
Pour cela j’ai relevé dans les « tables décennales »
les mois de naissance de 1065 enfants de 233 couples. Les autres couples résidaient
hors de Saint-Mathurin, avaient fait baptiser leurs enfants ailleurs, ou n’avaient
pas eu d’enfants. Ce travail ne permet pas une étude complète
des naissances par couple, car il manque les naissances après 1790, et
les naissances hors de Saint-Mathurin.
Trois catégories ont été établies : bêcheurs (158 mariages, 737 baptêmes), laboureurs (37 mariages, 165 baptêmes) et artisans (26 mariages, 107 baptêmes). Le nombre de baptêmes à chaque mois, a été modifié en proportion inverse du nombre de jours dans le mois, pour établir une moyenne sur 30.44 jours. Après quoi la date de conception a été trouvée en décalant de 9 mois à partir du mois de baptême. Le mouvement saisonnier est donc calculé à partir de 12 mois de même durée.
On observe sur la courbe des conceptions des bêcheurs une baisse au mois de juin et surtout en fin d’année, entre septembre et décembre, avec un minimum en octobre.
La courbe des laboureurs connaît par contre la même forte baisse au mois d’octobre, que l’on peut attribuer aux travaux des champs. Mais il n’y a pas de creux en juin, qui est le mois des conceptions sont les plus nombreuses. Par ailleurs on observe un creux au mois de mars. Une baisse des conceptions à l’époque du Carême a souvent été observé dans d’autres communautés. Jacques Dupâquier l’attribuait à un changement d’alimentation plutôt qu’à un espacement des relations conjugales10. Dans le cas présent, ce creux n’est pas très sensible, et limité aux laboureurs. La courbe conceptions dans les familles d’artisans est plus irrégulière, peut-être à cause du faible nombre de données. Elle permet malgré tout d’observer la même baisse des conceptions en automne, après des maximums entre mai et juillet.
graphique 5
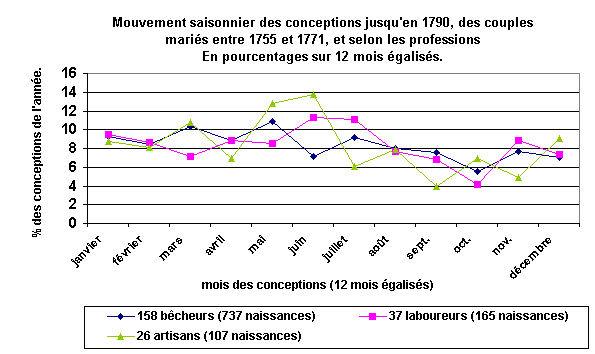
NOTES DE BAS DE PAGE (WEB)
1
Jacques Dupâquier. Histoire de la population française. T2/
De la renaissance à 1789. page 296.
2
Moinard Annabelle. Saint Lambert du Lattay. Une paroisse angevine de 1715
à 1789.
3
Yannick Neau. Une paroisse d’Anjou. Carbay au XVIIIe siècle.
4
Bénédicte Dezanneau. Les hommes et la Loire à Saint
Clément des levées. 1750-1789. page 126. Yannick Neau. Une
paroisse d’Anjou. Carbay au XVIIIe siècle. page 29. Annabelle
Moinard. Saint Lambert du Lattay. Une paroisse angevine de 1715 à
1789. ainsi que deux ouvrages cités par Yannick Neau : Patrick
Paineau, Chanteloup. Une paroisse du bocage bressuirais. et de L. Hamard,
Saint Michel du Bois au XVIIIe siècle (1707-1790).
5
François Lebrun. Les hommes et la mort en Anjou aux 17e
et 18e siècle. page 197. Il attribue ce repli à
des conditions climatiques favorables et à l’absence de grandes
épidémies meurtrières.
6
Jacques Dupâquier. op. cit. page 316.
7
Bénédicte Dezanneau. op. cit. page 127
8
Yannick Neau. op. cit. page 36.
9
D’après le Quid98, page 1303.
10
Jacques Dupâquier. op. cit. page 404